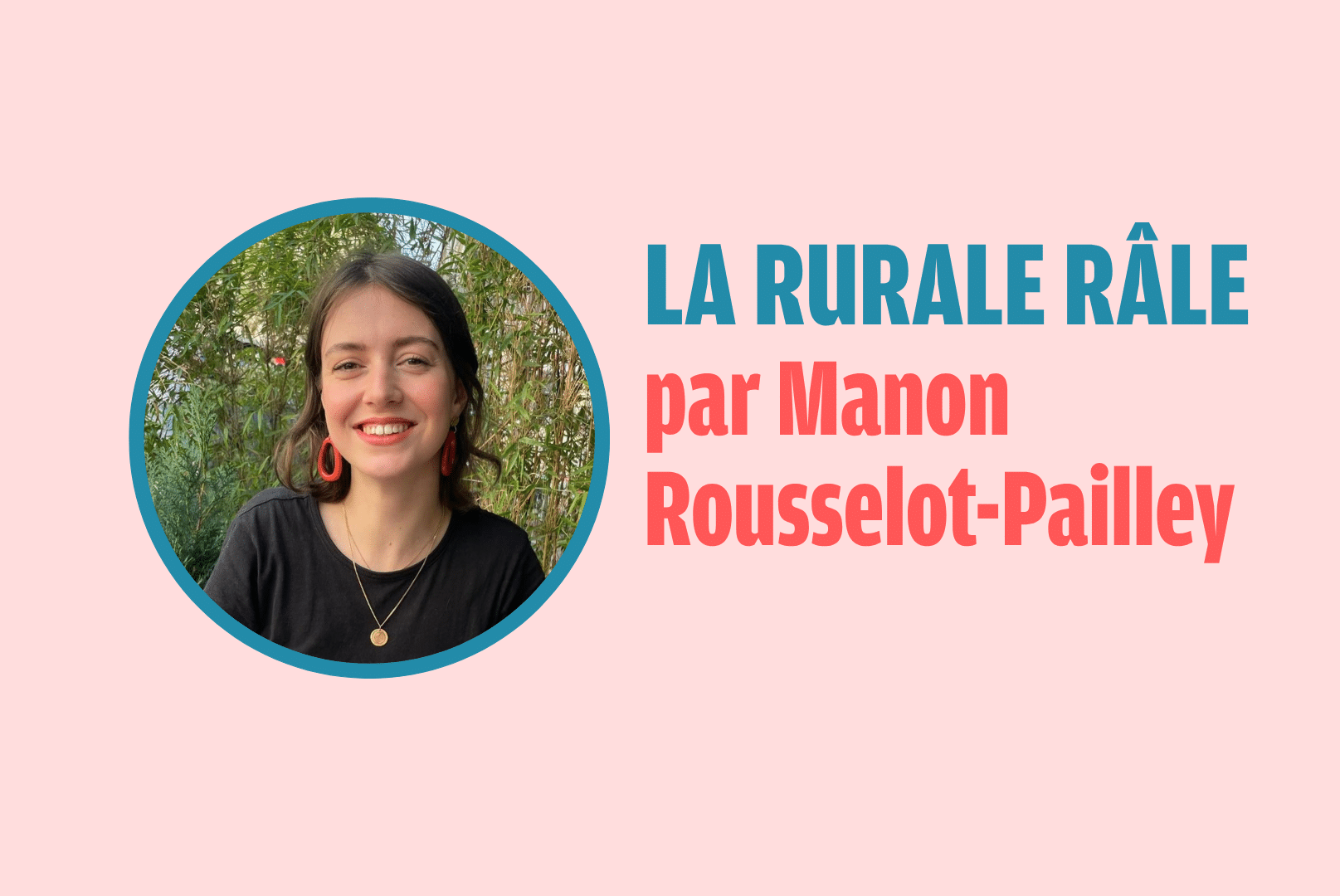Tout a commencé à Paris, comme bon nombre de nos problèmes. Au moment de passer la porte d’un restaurant, fini le « Bonjour, vous avez réservé ? ». Un jeune cadre en doudoune sans manches nous alpague : « Salut ! Tu connais le concept ? » Aujourd’hui, on ne vend plus un service ni un produit, on vend un concept, une « expérience insolite qui va vous surprendre ». On ne remerciera jamais assez les écoles de commerce et la start-up nation pour leur obsession de l’innovation. Seulement voilà : une fois détournés divers lieux de leur usage (une caserne de pompiers reconvertie en restaurant, un bureau de poste en bar à cocktails…), une fois changée la forme de toutes les nourritures et fusionnées toutes les cuisines possibles (connaissez-vous le « tacosushi » ?), nos apprentis sorciers se sont retrouvés à court d’inspiration.
Pitié, arrêtez ça !
Pour rester compétitifs, ces petits génies se sont mis à tout « revisiter », et n’importe comment. C’est ainsi que sont nés des restaurants comme Le Cornichon. Son projet : recréer l’ambiance d’un PMU, mais à destination des CSP+. Un bon exemple de gentrification culturelle, l’appropriation par la classe dominante de pratiques populaires en les nettoyant au préalable de ce qui ne convient pas à l’esthétique recherchée, en l’occurrence les pauvres. Plus tristement encore, cet appétit pour la gentrification a rencontré la romantisation du rural, pour un mariage du plus mauvais goût. La ruralité oscille encore entre deux fantasmes urbains : d’un côté la misère sociale, de l’autre la carte postale bucolique.
L’heure des crocs
Tout cela engendre souvent un complexe de sauveur urbain d’une part, et d’autre part une recherche d’authenticité et de tradition qui peut vite dégénérer. J’en prends pour exemple
Gueuleton, un compte Instagram qui se décrit comme « bon vivant » et qui est suivi par 565 000 personnes. Le site Internet de ce « projet de copains », couvert de photos de la France du siècle dernier, est animé par deux entrepreneurs qui ont créé une esthétique fantasmée autour de ce qu’ils revendiquent comme « nos racines, notre patrimoine, un art de vivre à la campagne », à savoir organiser de grands buffets de viande. La viande, pourtant, n’a jamais appartenu à l’alimentation paysanne traditionnelle. Sa consommation n’a explosé qu’avec les Trente Glorieuses et l’industrialisation agricole. Ce n’est pas tant l’inexactitude sociologique et historique qui me dérange ici que les conséquences politiques de ces imaginaires. On célèbre une France rurale et carnivore en écartant du débat l’écologie, la diversité des pratiques alimentaires (et religieuses) et l’état de l’agriculture en France. Ce sont ainsi les idées d’extrême droite qui se retrouvent les mieux nourries, en qualité comme en quantité.
Cette chronique publiée dans le premier numéro du Cri vous est offerte. N’hésitez pas à acheter ce numéro ou à vous abonner pour lire les prochains textes de Manon !